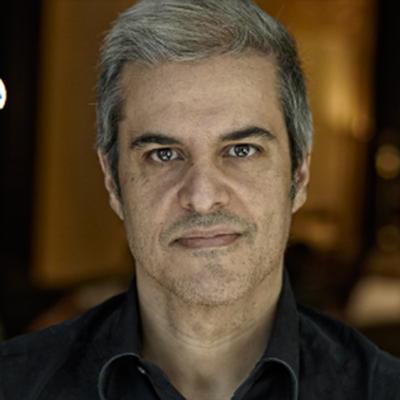Le mouvement qui a eu raison de la dictature de Ben Ali était peu structuré, totalement imprévisible et sans autre unité que le sentiment de ras-le-bol d’une grande partie de la population tunisienne. Ses débuts étaient comme une révolte de la faim ou comme on dit dans le monde arabe, une « révolte du pain » : un jeune diplômé se suicide parce que la police brise son étalage ambulant dans une petite ville à quelque 260 km de Tunis, dans une zone interne laissée pour compte, par rapport aux zones côtières qui attirent le tourisme. Si le mouvement s’est répandu tel une traînée de poudre, cela tient à plusieurs facteurs dont le plus important est la fragilité de la dictature tunisienne.
Vieillissant et peu motivé, ne comprenant plus la société ni les nouvelles classes dirigeantes, Ben Ali, dont la famille avait mis en coupe réglée la Tunisie, n’a pas marqué une grande détermination à se défendre. Tel un château de cartes, le pouvoir s’est écroulé en moins d’un mois, alors qu’il était perçu de l’extérieur comme redoutable, solide et stable. Il avait plutôt mieux réussi sur le front économique qu’en Egypte ou en Algérie, mais son problème était ailleurs, dans l’incompréhension de la nouvelle société en voie de constitution, et dans le profond sentiment d’injustice qui travaillait la population face à un fossé de classes qui s’est transformé, depuis plus de deux décennies, en un abîme, entre une petite classe de privilégiés et une population souvent au bord du désespoir, tant elle se sentait démunie et exclue. A cela s’ajoute un système de répression et d’intimidation qui était l’un des plus redoutables et des plus craints du monde arabe et un système de corruption familiale qui n’a eu son égale qu’en Egypte ou dans la haute hiérarchie militaire en Algérie.
La chute de Ben Ali n’est pas sans rappeler celle du chah d’Iran : comme Ben Ali, le chah avait vieilli et avait pris son pouvoir absolu comme allant de soi, avec tous les aspects révoltants d’un pouvoir despotique ignorant l’évolution sociale. Seulement, en opposition au chah, il y avait la personnalité charismatique de l’ayatollah Khomeyni qui voulait instaurer une autre autocratie au nom du gouvernement du juriste islamique (velayat-e faqih). Il réussit parce que les nouvelles classes moyennes iraniennes étaient dépourvues de direction politique et morale.
Déficit de légitimité
En Tunisie, une telle alternative est exclue et le contexte international n’est plus ce qu’il était sous le chah. L’analogie avec l’Iran s’arrête là. Malgré une mobilisation extrêmement forte, le Mouvement vert de juin 2009 n’a pas pu renverser l’autocratie islamique en Iran parce que le pouvoir théocratique était beaucoup plus structuré et ne présentait pas les mêmes signes de vieillissement et de faiblesse que le régime Ben Ali. Il est vrai que les dirigeants politiques comme Moussavi ou Karrubi se réclamaient d’une ambition limitée et entendaient procéder à des réformes au sein du système, ce qui protégeait le pouvoir contre le débordement collectif. Mais peut-être que dans une nouvelle phase, dans l’avenir, on assistera à l’affaiblissement du régime théocratique, dans l’ère d’après-Khamenei.
La chute de Ben Ali déstabilise, qu’on le veuille ou non, d’autres gouvernements arabes autocratiques de la région, que ce soit l’Egypte, l’Algérie, la Jordanie ou encore, peut-être dans une moindre mesure, le Maroc. Tous ces régimes souffrent d’un déficit de légitimité important, tous sont fondés sur une vision antidémocratique de la société, tous se nourrissent, à des degrés divers, de la corruption et de la concentration indue du pouvoir aux mains d’une personne ou d’un groupe restreints de militaires. Tous tablent sur le soutien direct ou indirect de l’Occident face à l’islamisme radical qu’ils brandissent comme un épouvantail. Celui-ci se revigore de leur continuité, en dénonçant le caractère « pourri » du pouvoir en place.
Le grand atout dont bénéficient ces mouvements est, paradoxalement, leur faible organisation, leur caractère diffus et leur totale imprévisibilité. L’Internet les aide à diffuser les images de la répression à l’extérieur, mais leur force principale réside dans la putréfaction interne des pouvoirs despotiques qui n’ont plus rien à proposer, ni aux autres ni à leurs propres partisans. Quant aux pays occidentaux, il serait temps qu’ils comprennent enfin le choix fondamental qu’ils ont désormais : soit soutenir des dictatures de plus en plus en voie de dégénérescence, soit abonder dans le sens de l’aspiration d’une partie grandissante de la population du monde arabe et musulman qui cherche à se doter de pouvoirs pluralistes et ouverts.
Les Tunisiens, la population la plus sécularisée de l’Afrique du Nord, ne semblent pas incliner dans le sens de l’islam politique. Malgré une opposition politique décapitée, la vision démocratique peut guider l’ensemble des partisans de la stabilité en Tunisie et ouvrir la voie à un gouvernement d’unité nationale, démocratiquement inspirée. Mais les écueils sont nombreux et le discrédit qui pèse sur le système politique peut rendre difficile la constitution d’un pouvoir crédible.
L’aide internationale, et en particulier française, serait précieuse, ne serait-ce que pour pouvoir se racheter, tant la France et plus généralement la plupart des pays occidentaux se sont montrés frileux vis-à-vis du mouvement de protestation qui a secoué la Tunisie ce mois-ci.
Farhad Khosrokhavar, sociologue, directeur d’études à l’EHESS
Source: http://www.lemonde.fr/